Abbaye Saint-André-le-Bas, historique

Les origines de l'abbaye Saint-André-le-Bas remontent au milieu du
VIème siècle. Elles mettent au premier plan un notable viennois, le
duc Ansemond, qui a déjà fait des donations en faveur de l'église
Saint-Pierre. Il demanda qu'un nouveau monastère consacré à saint André
soit élevé auprès de sa sépulture. De cette époque ne reste que peu de
vestiges, quelques parties intérieures du mur nord de l'église.

 Ce nouveau lieu de culte fut construit dans un quartier urbanisé depuis
les temps romains, ce qui explique que l'on trouve dans le sous-sol
des vestiges de murs de l'époque antique sur lesquels on a bâti le
monastère.
Ce nouveau lieu de culte fut construit dans un quartier urbanisé depuis
les temps romains, ce qui explique que l'on trouve dans le sous-sol
des vestiges de murs de l'époque antique sur lesquels on a bâti le
monastère.

 Mentionnée au VIIème siècle comme monastère de femmes, l'abbaye fut
délaissée aux VIIIème et IXème siècles jusqu'au jour où Boson, roi de
Bourgogne et de Provence, qui avait fait de Vienne sa capitale,
restaura la vie religieuse, créant à Saint-André un chapitre de
chanoines. L'église devint la chapelle du palais.
Mentionnée au VIIème siècle comme monastère de femmes, l'abbaye fut
délaissée aux VIIIème et IXème siècles jusqu'au jour où Boson, roi de
Bourgogne et de Provence, qui avait fait de Vienne sa capitale,
restaura la vie religieuse, créant à Saint-André un chapitre de
chanoines. L'église devint la chapelle du palais.

 Au Xème siècle, les
souverains du royaume de Bourgogne continuèrent à honorer et protéger
leur église palatiale qui reçut un second patron, saint Maxime. Le roi
Conrad prit l'initiative d'y recréer un monastère sous la règle de
saint Benoît. Selon la tradition, Conrad aurait été inhumé dans
l'église.
Au Xème siècle, les
souverains du royaume de Bourgogne continuèrent à honorer et protéger
leur église palatiale qui reçut un second patron, saint Maxime. Le roi
Conrad prit l'initiative d'y recréer un monastère sous la règle de
saint Benoît. Selon la tradition, Conrad aurait été inhumé dans
l'église.
 Au cours des XIème et XIIème siècles, acquisitions et donations ne
cessèrent d'accroître le domaine. L'église fut agrandie et surélevée.
Puis commença un chantier qui transforma l'abbaye : le clocher fut
élevé, le cloître reconstruit, l'église agrandie et voûtée.
Au cours des XIème et XIIème siècles, acquisitions et donations ne
cessèrent d'accroître le domaine. L'église fut agrandie et surélevée.
Puis commença un chantier qui transforma l'abbaye : le clocher fut
élevé, le cloître reconstruit, l'église agrandie et voûtée.

 C'est de cette époque que date l'ornementation sculptée,
particulièrement dans l'église, où maître Guillaume, fils de Martin, a
laissé sur une inscription la date de ses réalisations : 1132. Son
atelier et celui de Saint-Maurice sont en contact, s'influençant
mutuellement. Les modèles bourguignons ne leur sont pas étrangers.
C'est de cette époque que date l'ornementation sculptée,
particulièrement dans l'église, où maître Guillaume, fils de Martin, a
laissé sur une inscription la date de ses réalisations : 1132. Son
atelier et celui de Saint-Maurice sont en contact, s'influençant
mutuellement. Les modèles bourguignons ne leur sont pas étrangers.
 Au XIIIème siècle l'abbé obtient du pape le droit de porter la mitre.
Le quartier dans laquelle elle est implantée, appelé la Grande
Paroisse, joue un rôle particulier dans la ville, en particulier à
cause de la population juive qui y est nombreuse (elle apparaît à ce
titre fréquemment dans les archives de l'abbaye).
Au XIIIème siècle l'abbé obtient du pape le droit de porter la mitre.
Le quartier dans laquelle elle est implantée, appelé la Grande
Paroisse, joue un rôle particulier dans la ville, en particulier à
cause de la population juive qui y est nombreuse (elle apparaît à ce
titre fréquemment dans les archives de l'abbaye).
 Au delà du XIIIème siècle, l'histoire de l'abbaye n'offrit plus guère
d'évènements majeurs. Dans ses locaux se tinrent parfois les réunions
des consuls. A partir du XVIème siècle, le nombre de religieux diminua.
Son existence fut remise en cause dès le début du XVIIIème siècle, et
finalement, elle fut supprimée en 1772.
Au delà du XIIIème siècle, l'histoire de l'abbaye n'offrit plus guère
d'évènements majeurs. Dans ses locaux se tinrent parfois les réunions
des consuls. A partir du XVIème siècle, le nombre de religieux diminua.
Son existence fut remise en cause dès le début du XVIIIème siècle, et
finalement, elle fut supprimée en 1772.
 Suite à la vente de l'abbaye à la révolution et à des transformations
effectuées au XIXème siècle, les arcades du cloître furent murées. Des
locaux privatifs et publics, comme la chambre de commerce, occupaient l'espace des galeries.
Suite à la vente de l'abbaye à la révolution et à des transformations
effectuées au XIXème siècle, les arcades du cloître furent murées. Des
locaux privatifs et publics, comme la chambre de commerce, occupaient l'espace des galeries.
Abbaye Saint-André-le-Bas, le cloître
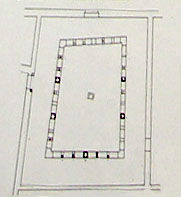 Le
cloître roman n'est pas mitoyen de l'abbatiale. Un passage, aujourd'hui
ouvert, les sépare. L'irrégularité du plan trapézoïdal serait imposé
par des structures antérieures qui ont été perçues lors des travaux de
restauration. Le mur nord avec ses lits de briques peut remonter aux
constructions du haut moyen âge.
Le
cloître roman n'est pas mitoyen de l'abbatiale. Un passage, aujourd'hui
ouvert, les sépare. L'irrégularité du plan trapézoïdal serait imposé
par des structures antérieures qui ont été perçues lors des travaux de
restauration. Le mur nord avec ses lits de briques peut remonter aux
constructions du haut moyen âge.
 Des
bâtiments conventuels ne subsistent plus que les galeries du cloître
qui ont été construites en une seule campagne : l'aile sud a été
démembrée et les autres ont été intégrées dans des constructions
adjacentes. Elles n'ont pas été voûtées mais couvertes d'un plafond en
bois peint à caissons.
Des
bâtiments conventuels ne subsistent plus que les galeries du cloître
qui ont été construites en une seule campagne : l'aile sud a été
démembrée et les autres ont été intégrées dans des constructions
adjacentes. Elles n'ont pas été voûtées mais couvertes d'un plafond en
bois peint à caissons.
 Une
partie du plafond lambrissé actuel date de la fin du XVème siècle. Une
gravure du début du XIXème siècle a aidé à sa restauration achevée en
1938, mais elle ne restitua pas intégralement les dispositions
d'origine. C'est ainsi que le "cloître haut", au-dessus des galeries
du rez-de-chaussée, n'a pas été maintenu. Il reste quand même le seul
cloître roman complet de la région Rhône-Alpes.
Une
partie du plafond lambrissé actuel date de la fin du XVème siècle. Une
gravure du début du XIXème siècle a aidé à sa restauration achevée en
1938, mais elle ne restitua pas intégralement les dispositions
d'origine. C'est ainsi que le "cloître haut", au-dessus des galeries
du rez-de-chaussée, n'a pas été maintenu. Il reste quand même le seul
cloître roman complet de la région Rhône-Alpes.

 Sur
les 4 côtés le rythme des arcades est identique, mais pas leur nombre :
deux travées sur les petits côtés nord et sud, trois sur les longs
côtés.
Sur
les 4 côtés le rythme des arcades est identique, mais pas leur nombre :
deux travées sur les petits côtés nord et sud, trois sur les longs
côtés.
Les baies sont constituées par trois arcades de plein
cintre retombant d'une part sur deux groupes de colonnettes géminées
reliées par le même tailloir, et d'autre part sur des piliers qui
délimitent les travées.
 Le
mur bahut est doublé à l'intérieur d'une banquette. Sur le côté est, on
voit encore la porte de la salle capitulaire, qui fut surmontée d'un
arc gothique posé sur deux culs-de-lampe ornés de têtes. De chaque côté
s'ouvraient les baies.
Le
mur bahut est doublé à l'intérieur d'une banquette. Sur le côté est, on
voit encore la porte de la salle capitulaire, qui fut surmontée d'un
arc gothique posé sur deux culs-de-lampe ornés de têtes. De chaque côté
s'ouvraient les baies.

 Les
chapiteaux sont essentiellement végétaux, plus ou moins fortement
inspirés de modèles corinthiens. Parmi eux figurent Samson déchirant le
lion ou encore un ours dans une vigne. Certains fûts de colonnes sont
ornés de motifs inspirés de l'architecture antique : imbrications de
feuilles, rais de cœurs, perles.
Les
chapiteaux sont essentiellement végétaux, plus ou moins fortement
inspirés de modèles corinthiens. Parmi eux figurent Samson déchirant le
lion ou encore un ours dans une vigne. Certains fûts de colonnes sont
ornés de motifs inspirés de l'architecture antique : imbrications de
feuilles, rais de cœurs, perles.

Abbaye Saint-André-le-Bas, les collections lapidaires
 L'ensemble
le plus important est constitué par une série d'épitaphes chrétiennes
en latin dont la plus ancienne est celle d'une viennoise, Foedula,
datant du Vème siècle.
L'ensemble
le plus important est constitué par une série d'épitaphes chrétiennes
en latin dont la plus ancienne est celle d'une viennoise, Foedula,
datant du Vème siècle.
 Les
inscriptions médiévales forment un second ensemble, généralement des
monuments funéraires, dont une en langue hébraïque, de Samuel, fils de
Rabbi Justus, datant du Xème siècle.
Les
inscriptions médiévales forment un second ensemble, généralement des
monuments funéraires, dont une en langue hébraïque, de Samuel, fils de
Rabbi Justus, datant du Xème siècle.

 Dans
l'angle sud-est du cloître sont regroupés des éléments de mobilier en
pierre provenant des anciennes églises de Vienne : fragments de chancel
et autels en marbre. L'autel en marbre blanc provient de l'église
Saint-Pierre et date de la première moitié du XIème siècle. Il fut
taillé dans un bloc unique. Trois colonnettes octogonales surmontées de
chapiteaux cubiques portent la table de forme semi-circulaire. La
cuvette centrale est délimitée par des moulures et entourée de 6 lobes.
Dans
l'angle sud-est du cloître sont regroupés des éléments de mobilier en
pierre provenant des anciennes églises de Vienne : fragments de chancel
et autels en marbre. L'autel en marbre blanc provient de l'église
Saint-Pierre et date de la première moitié du XIème siècle. Il fut
taillé dans un bloc unique. Trois colonnettes octogonales surmontées de
chapiteaux cubiques portent la table de forme semi-circulaire. La
cuvette centrale est délimitée par des moulures et entourée de 6 lobes.
 Des
sarcophages ont été placés dans la galerie est. Certains datent du
IIème siècle, d'autres du IVème, d'autres du VIIIème siècle. L'un d'eux
fut réutilisé pour la sépulture d'un des chanoines de la cathédrale. Le
panneau central est décoré d'un chrisme inscrit dans une couronne.
Des
sarcophages ont été placés dans la galerie est. Certains datent du
IIème siècle, d'autres du IVème, d'autres du VIIIème siècle. L'un d'eux
fut réutilisé pour la sépulture d'un des chanoines de la cathédrale. Le
panneau central est décoré d'un chrisme inscrit dans une couronne.

Abbaye Saint-André-le-Bas, l'abbatiale
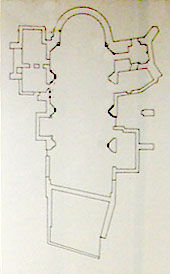 C'est,
mis à part l'abside et quelques adjonctions postérieures, l'église
reconstruite vers le milieu du XIIème siècle que l'on découvre en
entrant à l'intérieur du bâtiment. Elle fut difiée sur une plateforme
artificielle romaine, dont un passage voûté subsiste sous les travées
occidentales. Du Xème siècle ne subsistent que l'élévation des murs
gouttereaux, aux baies en plein cintre comblées ainsi que l'abside,
reconnaissable à l'alternance d'assises de briques et de pierre.
C'est,
mis à part l'abside et quelques adjonctions postérieures, l'église
reconstruite vers le milieu du XIIème siècle que l'on découvre en
entrant à l'intérieur du bâtiment. Elle fut difiée sur une plateforme
artificielle romaine, dont un passage voûté subsiste sous les travées
occidentales. Du Xème siècle ne subsistent que l'élévation des murs
gouttereaux, aux baies en plein cintre comblées ainsi que l'abside,
reconnaissable à l'alternance d'assises de briques et de pierre.

 C'est
un édifice basilical sans transept remployant de part et d'autre de
l'abside deux colonnes antiques aux chapiteaux corinthiens. Une nef
unique se termine par l'abside dont l'ouverture est à peine moins
large.
C'est
un édifice basilical sans transept remployant de part et d'autre de
l'abside deux colonnes antiques aux chapiteaux corinthiens. Une nef
unique se termine par l'abside dont l'ouverture est à peine moins
large.
 Le
rythme des travées est souligné par des pilastres cannelés qui évoquent
l'architecture romaine. Les doubleaux, en arc brisé, polychromes,
retombent sur les pilastres par des chapiteaux. C'est là en particulier
que le maître Guillaume a créé des œuvres de belle qualité : une
inscription placée à la base d'un des pilastres de la nef, "Willelmus
Martini me fecit anno Domini 1152" (Guillaume fils de Martin m'a fait
ou m'a fait faire en l'an du Seigneur 1152) en fait foi.
Le
rythme des travées est souligné par des pilastres cannelés qui évoquent
l'architecture romaine. Les doubleaux, en arc brisé, polychromes,
retombent sur les pilastres par des chapiteaux. C'est là en particulier
que le maître Guillaume a créé des œuvres de belle qualité : une
inscription placée à la base d'un des pilastres de la nef, "Willelmus
Martini me fecit anno Domini 1152" (Guillaume fils de Martin m'a fait
ou m'a fait faire en l'an du Seigneur 1152) en fait foi.

 L'influence
antique imprègne aussi les chapiteaux à feuillages de type corinthien.
Deux chapiteaux figurés s'inspirent d'épisodes bibliques, Samson
terrassant le lion, et les malheurs de Job.
L'influence
antique imprègne aussi les chapiteaux à feuillages de type corinthien.
Deux chapiteaux figurés s'inspirent d'épisodes bibliques, Samson
terrassant le lion, et les malheurs de Job.
 Sur
les pilastres des arcatures méridionales, des chapiteaux s'ornent de
scènes énigmatiques : des Vénus s'opposent aux forces du mal, des
créatures monstrueuses.
Sur
les pilastres des arcatures méridionales, des chapiteaux s'ornent de
scènes énigmatiques : des Vénus s'opposent aux forces du mal, des
créatures monstrueuses.
La décoration se déploie aussi sur les
parties hautes de la nef : un bandeau horizontal avec masques et
fleurs, une frise souligne la division des murs, deux fenêtres hautes à
colonnettes sont portées par un lion et un acrobate.

 L'arc triomphal de l'abside retombe sur des chapiteaux corinthiens et des colonnes cannelées d'origine antique.
L'arc triomphal de l'abside retombe sur des chapiteaux corinthiens et des colonnes cannelées d'origine antique.
La nef est recouverte selon une technique nouvelle à l'époque : voûte à nervures avec un profil très bombé.

 A
partir du XIIIème siècle, des chapelles sont ajoutées à l'édifice. Les
stalles du chœur datent du début du XVIIIème siècle. La partie
occidentale, la façade, sont des restaurations récentes (1928).
A
partir du XIIIème siècle, des chapelles sont ajoutées à l'édifice. Les
stalles du chœur datent du début du XVIIIème siècle. La partie
occidentale, la façade, sont des restaurations récentes (1928).

 Vienne fut habitée depuis très longtemps : des traces de l'époque néolithique et de l'âge du Bronze en sont la preuve.
Vienne fut habitée depuis très longtemps : des traces de l'époque néolithique et de l'âge du Bronze en sont la preuve.  Au IIIème siècle avant notre ère, les Celtes, originaires de la Hongrie actuelle, arrivent sur ce territoire et l'une de ces tribus, les Allobroges (les gens venus d'ailleurs), fonde sa capitale, Vienna.
Au IIIème siècle avant notre ère, les Celtes, originaires de la Hongrie actuelle, arrivent sur ce territoire et l'une de ces tribus, les Allobroges (les gens venus d'ailleurs), fonde sa capitale, Vienna.  En -44, une révolte gauloise chassa les Romains de Vienne qui fondèrent une autre colonie à proximité, à Lugdunum (Lyon). Mais sa fidélité à Rome, durant la guerre des Gaules, vaudra à Vienne le titre de colonie latine, donné par par Jules César sous le nom de Colonia Julia Viennensis, puis en l'an 40 celui de colonie romaine : les habitants possèdent alors tous les droits des citoyens romains.
En -44, une révolte gauloise chassa les Romains de Vienne qui fondèrent une autre colonie à proximité, à Lugdunum (Lyon). Mais sa fidélité à Rome, durant la guerre des Gaules, vaudra à Vienne le titre de colonie latine, donné par par Jules César sous le nom de Colonia Julia Viennensis, puis en l'an 40 celui de colonie romaine : les habitants possèdent alors tous les droits des citoyens romains. Vienne fut aussi la ville où apparait pour la première fois en Gaule une colonie juive, et où fut exilé Hérode Archélaos, ethnarque de Judée en l'an 6 de notre ère. La ville se développa de chaque côté du Rhône et devint l'une des plus grandes villes de Gaule : elle possède une enceinte de 7 km et se pare de monuments, édifiés sur des terrasses successives dominant le Rhône.
Vienne fut aussi la ville où apparait pour la première fois en Gaule une colonie juive, et où fut exilé Hérode Archélaos, ethnarque de Judée en l'an 6 de notre ère. La ville se développa de chaque côté du Rhône et devint l'une des plus grandes villes de Gaule : elle possède une enceinte de 7 km et se pare de monuments, édifiés sur des terrasses successives dominant le Rhône.  Au IVème siècle, la ville devint chef-lieu de la province Viennoise, puis capitale d'un diocèse de 7 provinces qui s'étendent sur la moitié sud de la France. Au Vème siècle, saint Mamert commença la construction de la basilique Saint-Pierre. Vers 470, Vienne devint l'une des villes principales du royaume burgonde. Durant cette période, la communauté chrétienne se développa et construisit églises et monastères.
Au IVème siècle, la ville devint chef-lieu de la province Viennoise, puis capitale d'un diocèse de 7 provinces qui s'étendent sur la moitié sud de la France. Au Vème siècle, saint Mamert commença la construction de la basilique Saint-Pierre. Vers 470, Vienne devint l'une des villes principales du royaume burgonde. Durant cette période, la communauté chrétienne se développa et construisit églises et monastères. Au cours du IXème siècle, Vienne devint capitale du royaume de Provence, après l'élection du roi Boson en 879. Au XIème siècle, l'empereur d'Allemagne hérita du royaume, Vienne fit alors partie du Saint Empire Romain Germanique.
Au cours du IXème siècle, Vienne devint capitale du royaume de Provence, après l'élection du roi Boson en 879. Au XIème siècle, l'empereur d'Allemagne hérita du royaume, Vienne fit alors partie du Saint Empire Romain Germanique.
 En 1311, la cathédrale Saint-Maurice abrita le concile œcuménique qui, sous la pression de Philippe le Bel, prononça la condamnation de l'ordre du Temple.
En 1311, la cathédrale Saint-Maurice abrita le concile œcuménique qui, sous la pression de Philippe le Bel, prononça la condamnation de l'ordre du Temple. Sur un portique de la ville, la devise stoïcienne "Sustine et Abstine", "Supporte et Abstiens-toi" est gravée. Elle aurait pu être la devise de Vienne, qui pourtant fut "Vienna civitas sancta", "Vienne cité sainte", puis à partir du XVIIIème siècle "Vienna urbs senatoria", "Vienne, ville sénatoriale".
Sur un portique de la ville, la devise stoïcienne "Sustine et Abstine", "Supporte et Abstiens-toi" est gravée. Elle aurait pu être la devise de Vienne, qui pourtant fut "Vienna civitas sancta", "Vienne cité sainte", puis à partir du XVIIIème siècle "Vienna urbs senatoria", "Vienne, ville sénatoriale". http://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Is%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Is%C3%A8re)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F1%2F116167.jpg)


























































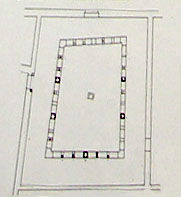













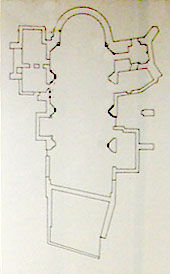



















































/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F65%2F43%2F137895%2F23065843_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F85%2F51%2F137895%2F5936798_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F37%2F137895%2F5493907_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F09%2F137895%2F6464861_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F137895%2F4447706_o.)